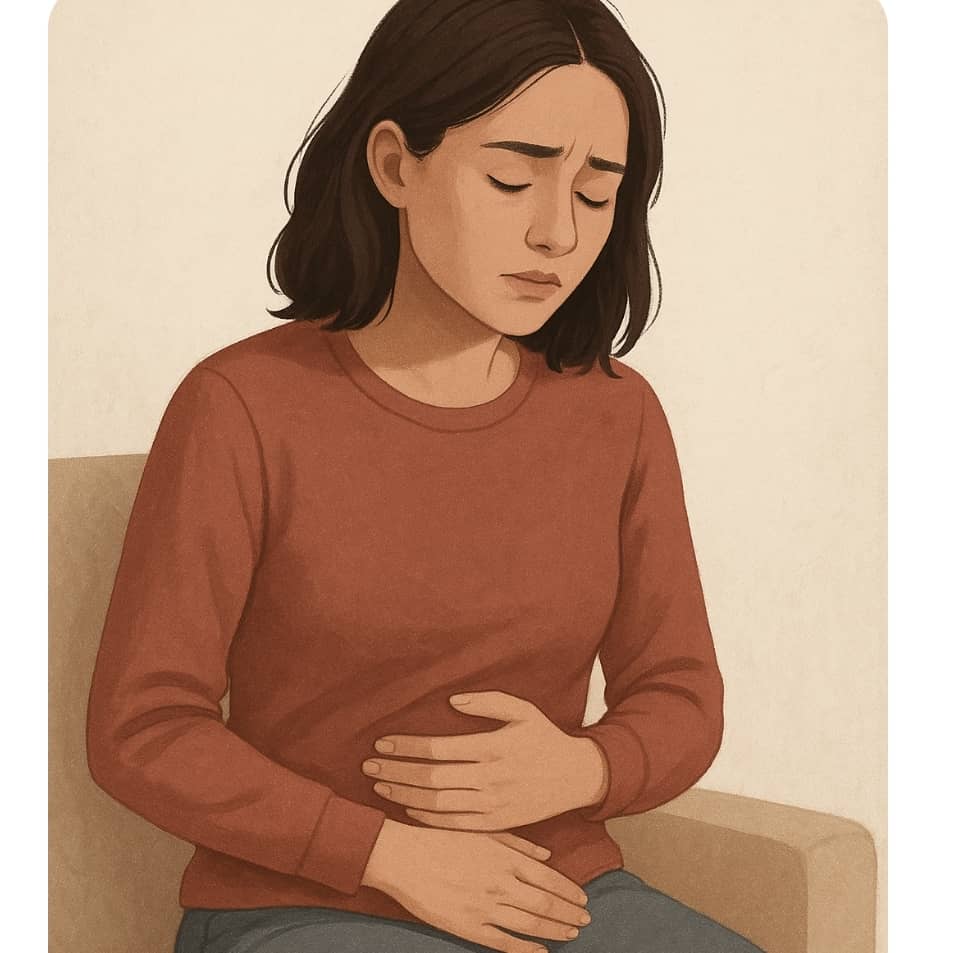Douleur pelvienne, règles très abondantes, difficulté à concevoir. Ici, il s’agit de l’endométriose. Cette maladie, liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus, touche de nombreuses femmes mais reste encore mal connue. Pour mieux comprendre ses causes, ses manifestations et les solutions possibles, un spécialiste en gynécologie explique ses principaux aspects.
L’endométriose, professeur, qu’est-ce que c’est ?
L’endométriose est une maladie qui survient chez certaines patientes, dont le principal symptôme est la douleur pendant les règles. Ces douleurs peuvent être si intenses qu’elles deviennent invalidantes, nécessitant parfois un repos complet et empêchant toute activité professionnelle.
Il existe deux formes :
- l’endométriose interne au muscle utérin, appelée adénomyose,
- et l’endométriose externe à l’utérus.
La cause la plus fréquente est un reflux menstruel à travers les trompes. Ce reflux, composé de cellules endométriales, passe dans la cavité pelvienne où il s’implante sur le péritoine. Cela provoque une réaction inflammatoire comparable à une réaction contre un corps étranger, entraînant ces douleurs particulièrement fortes.
Pourquoi a-t-on tendance à confondre l’endométriose avec de simples règles douloureuses ? Comment établir un diagnostic sûr ?
En réalité, les règles douloureuses ne sont pas différentes de l’endométriose : elles en sont l’un des symptômes. Cependant, le diagnostic ne peut pas reposer uniquement sur la symptomatologie. Certains signes doivent alerter, comme la présence de sang dans les urines avec des douleurs vésicales au moment des règles, ou du sang dans les selles concomitant aux menstruations. Cela oriente vers des lésions endométriosiques vésicales ou rectales, et donc vers l’endométriose, ce qui va bien au-delà de simples douleurs menstruelles.
Lorsque les douleurs deviennent invalidantes, nécessitant un alitement, il s’agit très probablement d’endométriose. Mais le diagnostic certain ne peut être posé qu’à travers un examen : l’IRM.
L’IRM permet d’identifier les lésions hémorragiques :
- à l’intérieur de l’utérus, pour diagnostiquer une adénomyose,
- ou à l’extérieur, au niveau du rectum, du péritoine, des ligaments utérosacrés, des ovaires (où peuvent apparaître des kystes endométriosiques), voire de la vessie.
C’est ainsi que l’on peut caractériser et confirmer la maladie.
quels sont les symptômes de l’endométriose ?
Les symptômes de l’endométriose se répartissent en deux catégories principales. La première concerne la douleur. Elle peut se manifester pendant les règles, ce que l’on appelle dysménorrhée, ou lors des rapports sexuels, appelée dyspareunie. Certaines patientes ressentent également des douleurs en dehors des règles, ainsi que des douleurs pelviennes chroniques liées aux lésions d’endométriose. La deuxième catégorie concerne l’infertilité. Certaines patientes rencontrent des difficultés à concevoir, et les examens d’imagerie comme l’IRM révèlent parfois des lésions sévères d’endométriose, telles que des trompes bouchées ou des hématosalpingues causées par l’inflammation. Ces deux aspects — douleur et infertilité — se complètent, ce qui rend indispensable une prise en charge globale, adaptée au niveau de douleur et au désir de grossesse, immédiat ou futur.
quelles sont les complications de l’endométriose ? Est-ce que la stérilité de la femme peut en dépendre ?
Les complications de l’endométriose sont rares. Principalement, il s’agit de gérer la douleur, qui peut être supportable ou non. Cependant, l’état inflammatoire de la cavité pelvienne peut provoquer une infertilité chez les patientes souhaitant concevoir. L’inflammation peut entraîner l’obstruction des trompes, parfois accompagnée de reflux menstruel, ce qui se traduit par des hydrosalpinx ou des hématosalpinx, contribuant également à la douleur. Les complications sévères restent exceptionnelles, comme la péritonite endométriosique due à la rupture d’un kyste endométriosique de plus de 15 cm. Ainsi, l’endométriose doit être prise en charge à la fois pour la douleur et pour la fertilité, avec un traitement personnalisé pour chaque patiente.
Quels sont les traitements de l’endométriose ?
L’endométriose se déclenche lorsque le reflux des règles provoque l’implantation de tissu semblable à la muqueuse utérine au niveau du péritoine, de la cavité pelvienne et de l’abdomen inférieur. Le traitement de cette pathologie repose sur des interventions ciblées et personnalisées. Il peut s’agir de l’ablation des lésions présentes dans l’ovaire, appelée kystectomie, visant à réduire la douleur et favoriser les grossesses ainsi que les ovulations. L’intervention peut également concerner les lésions douloureuses situées au niveau du cul-de-sac de Douglas ou de la face postérieure de l’utérus, et parfois les lésions digestives, nécessitant une résection spécifique pour soulager significativement les douleurs.
Dans certains cas, les trompes bouchées doivent être réparées afin de restaurer la fertilité, permettant une grossesse spontanée ou via assistance médicale à la procréation. L’approche globale de la patiente endométriose prend en compte à la fois la douleur et le désir de grossesse, et chaque traitement est adapté aux besoins individuels. La procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro, s’intègre ainsi parmi les options thérapeutiques lorsque cela s’avère nécessaire.
Parallèlement, le traitement médical constitue une alternative pour soulager la douleur. Ces traitements agissent en stoppant les règles, ce qui réduit les symptômes et améliore le confort des patientes. Parmi les options récentes figurent des médicaments tels que le Dienogest ou le Rielco, reconnus pour leur efficacité.
Certaines femmes peuvent nécessiter plusieurs interventions chirurgicales. Dans certains cas, la douleur diminue après chirurgie ; dans d’autres, elle persiste, indiquant que les lésions n’ont pas été totalement retirées. Pour l’endométriose digestive, une résection peut être indispensable. Lorsqu’un désir de grossesse est présent, il est recommandé de se tourner vers un centre spécialisé en procréation médicalement assistée.
Le choix du traitement dépend également de l’âge et des priorités de la patiente. Une jeune femme de 20 ans, très douloureuse mais sans projet de grossesse immédiat, pourra bénéficier d’une chirurgie incluant une résection digestive. En revanche, une patiente de 38 ans souhaitant concevoir pourra d’abord recourir à une fécondation in vitro pour préserver ses ovocytes ou embryons, suivie d’une intervention chirurgicale pour soulager la douleur, avec réimplantation éventuelle des embryons.
La chirurgie de l’endométriose demeure complexe et nécessite l’intervention d’équipes pluridisciplinaires expérimentées.